Photo de couverture: « Car accident, 1957 » de Seattle Municipal Archives
Table des matières
Conseils pour accidenté.e.s de la route
Mon conjoint a eu un accident de moto en novembre dernier. Suite à cet événement, nous avons dû entreprendre des démarches auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec.
J’ai décidé d’écrire cet article pour informer et aider ceux et celles qui éventuellement pourraient se trouver dans une telle situation, en présentant les diverses étapes à travers lesquelles nous sommes passés.
L’accident
Le 9 novembre 2020, par une belle journée douce d’automne, mon conjoint décide de prendre sa moto pour aller au boulot. Je lui avais dit le matin : « Il ne nous reste que très peu de belles journées chaudes, profite de ton nouveau permis ». Il était hésitant, mais il a quand même décidé de partir à moto. Son trajet du matin s’est bien déroulé, mais pas celui du soir…
L’automne, quand la brunante s’installe, tout peut arriver en une fraction de seconde. J’appelle mon conjoint à 16h30 pour lui dire qu’exceptionnellement, j’ai annulé mes cours d’accompagnement aux élèves pour arriver plus tôt à la maison : je lui ai suggéré que l’on devrait profiter de cette belle soirée pour faire de la moto. Et oui… Il a obtenu son permis de conduire à la fin de septembre et, depuis ce temps, nous avions pris l’habitude de faire de petites randonnées en soirée pour profiter de nos motos, et vivre des moments très agréables. Cet appel a changé le programme : mon conjoint s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C’est en arrivant sur la route 243, à 5 minutes de la maison, qu’une jeune femelle chevreuil a croisé son chemin.
Vers 17h50, je trouvais qu’il se faisait tard et je ne comprenais pas que mon conjoint ne soit pas encore arrivé : nous habitons à 30 minutes de son lieu de travail. J’ai donc composé son numéro de téléphone et c’est un policier qui m’a répondu. L’horreur vécue à cet instant est indescriptible ! On tente de nous sécuriser à propos de l’accident mais, émotionnellement, tant que nous n’avons pas constaté par nous-mêmes l’ampleur de l’événement, on imagine tous les scénarios possibles. Les seuls mots de cette conversation qui, jusqu’à aujourd’hui, me restent en mémoire, sont : « Il est vivant ».
J’ai pris ma voiture et je me suis rendue sur les lieux de l’accident. Mon conjoint était déjà en route vers l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins avec les ambulanciers (ce service est couvert par la SAAQ). Le policier m’a expliqué les circonstances de l’accident et a aussi mentionné que mon conjoint n’aurait rien pu faire pour éviter le chevreuil. La moto était en train d’être remorquée et on a glissé entre mes mains la carte de l’endroit où nous pourrions aller la récupérer.
On me dit que mon conjoint était conscient lors de la prise en charge par les ambulanciers mais qu’il était confus et avait perdu connaissance après son vol plané de 30 pieds. Étant moi-même patrouilleuse de ski, je comprends que c’est un accident important, mais il est en vie.
Direction hôpital… Arrivée sur place, le personnel m’accueille avec gentillesse et me dit que je dois attendre à cause des mesures sanitaires liées à la COVID. Bien qu’on m’ait spécifié qu’il était conscient et qu’il parlait, je suis tout de même rongée par l’inquiétude.
Au bout de 30 minutes, je redemande si je peux le voir et, finalement, on accepte. Ouf, le choc. Il a des blessures importantes au visage et il est difficile pour lui de rester éveillé. Je comprends qu’il a subi un TCC (traumatisme crânio-cérébral simple).
Après 15 points de suture au visage, il reçoit son congé et doit revoir le médecin deux jours plus tard ou revenir si les symptômes augmentent. À cause de la COVID, les hôpitaux tentent de garder le moins possible de personnes sur place.
Deux choses importantes à faire après un accident avec blessures
Une fois le choc passé, il faut s’occuper de la prise en charge du dossier en lien avec les réclamations. Or, ce n’est pas si simple quand on ne sait pas.
L’association pour les droits des accidentés (L’ADA) est un organisme à but non lucratif. Il peut vous aider, vous guider dans les démarches à entreprendre auprès de la SAAQ, vous soutenir dans ces durs moments qui nous rendent vulnérables, répondre à vos questions et vous accompagner tout au long du processus. Vraiment une belle association avec des gens compétents qui comprennent votre réalité !
Il faut absolument demander au médecin traitant de l’urgence le rapport initial de l’accident : vous en avez besoin pour faire votre réclamation. Si ce n’est pas fait au moment de l’accident, faites la demande le plus tôt possible aux archives de l’hôpital qui vous a pris en charge. Je vous recommande de faire les deux : lorsque les archives font parvenir les documents, il y a plus de détails sur l’accident, dont les rapports des ambulanciers.
Vous devez également ouvrir votre dossier d’accident auprès de la SAAQ. C’est possible de le faire en ligne, mais il est préférable de se rendre dans un point de service pour obtenir une pochette comprenant l’ensemble des documents à remplir. Le numéro de réclamation que vous allez recevoir est très important, car vous l’utiliserez tout au long du processus. Il faut absolument remplir tous les documents en inscrivant ce numéro de réclamation : si vous ne l’inscrivez pas, il pourrait y avoir du retard dans le traitement de votre dossier. Si vous devenez inapte pour un retour au travail, votre employeur doit remplir un formulaire (inclus dans la pochette). Toutes vos réclamations passent par votre numéro de dossier, gardez-le précieusement. Assurez-vous de remplir soigneusement votre demande.
Vous pouvez aussi voir avec votre employeur si la période de carence est couverte par votre banque de congés de maladie, car la prise en charge par la SAAQ se fait seulement après 7 jours d’absence du travail. Si vous n’avez pas cette possibilité, vous pouvez faire une demande de prestations de maladie auprès de l’assurance-emploi qui, selon votre situation, peut vous aider en attendant que la SAAQ étudie votre dossier.
Indemnités et remboursements
L’indemnité de remplacement du revenu versée par la SAAQ correspond à 90% de votre revenu se basant sur votre salaire annuel (90% du revenu net calculé sur la base d’un revenu brut annuel, qui ne peut excéder 83 000 $). La SAAQ offre une prestation temporaire dès qu’elle accuse réception de votre demande. Cette prestation est réévaluée une fois que l’analyse de votre dossier est complétée.
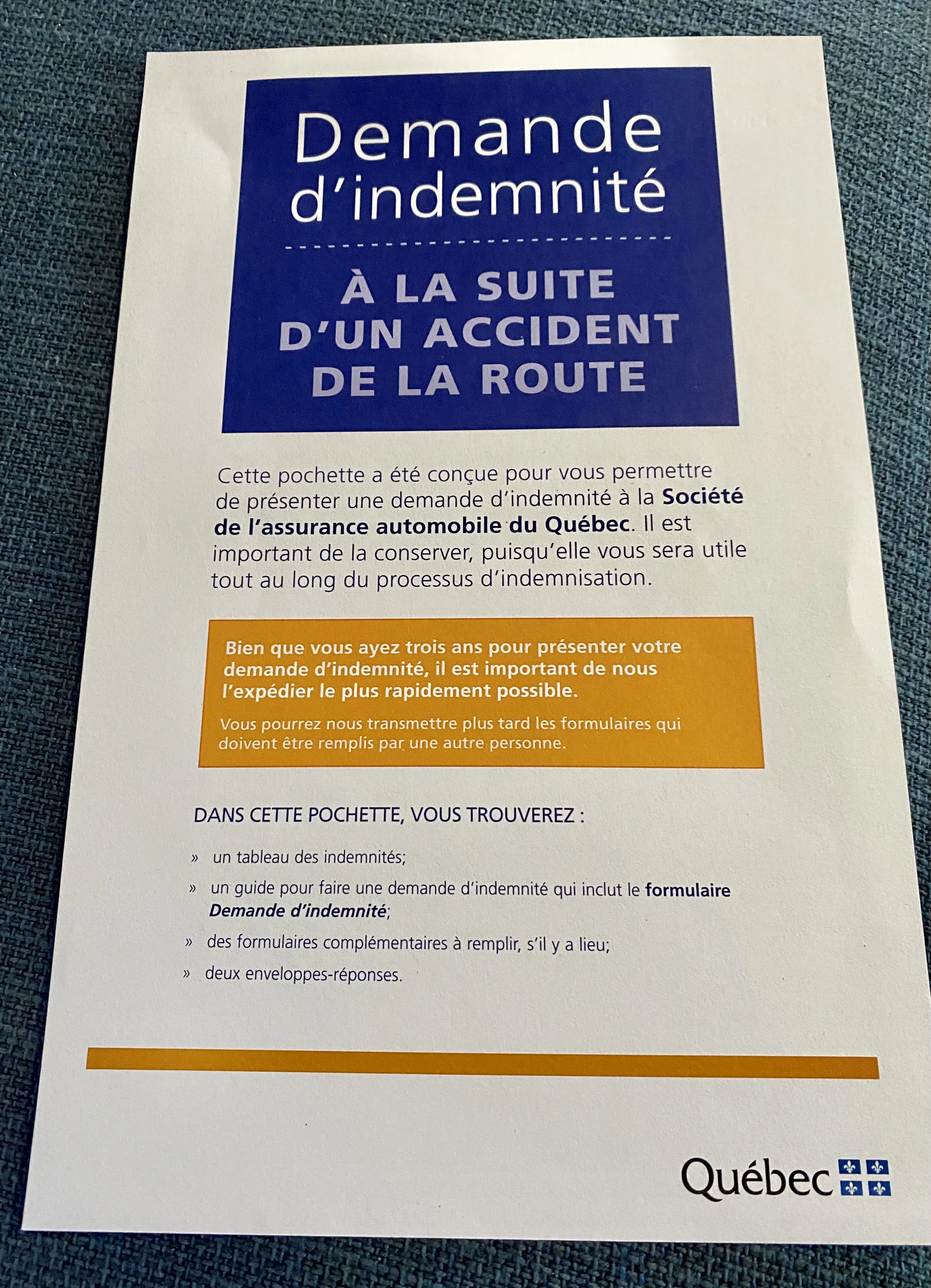
Les frais de médicaments et de soins sont en grande partie couverts. Il faut avoir des prescriptions du médecin traitant pour obtenir des soins comme la physiothérapie, une chirurgie plastique, ou encore pour rencontrer d’autres spécialistes. Les frais de remplacement de vêtements sont couverts jusqu’à concurrence de 1000 $ sur présentation de factures.
Un agent de réclamation vous est attitré (avec un numéro de téléphone pour le joindre). Vous recevrez le tout par courrier.
En fait, il faut vraiment conserver l’ensemble de vos papiers dans votre dossier et les faire parvenir le plus rapidement possible au bureau des réclamations de la SAAQ, en inscrivant bien votre numéro de réclamation.
Pour terminer
Je voudrais terminer cet article en disant que j’ai fait toutes les démarches pour mon conjoint puisqu’il n’était pas en mesure de le faire à cause de sa condition suite à l’accident. Il faut donc être bien entouré et demander de l’aide si vous êtes seul face à ce genre d’événement. L’ADA est là pour vous aider.
Aujourd’hui encore, après un mois et demi, mon conjoint a des séquelles suite à sa commotion cérébrale, les symptômes s’accentuent.
Il faut absolument se rendre voir un médecin tout de suite après un accident de moto et ce, même si vos blessures sont superficielles. Il faut également ouvrir un dossier auprès de la SAAQ. On ne sait jamais comment notre corps peut réagir suite à un accident et quelles séquelles peuvent apparaître et demeurer.
En espérant que cet article pourra aider d’autres motocyclistes dans cette situation.
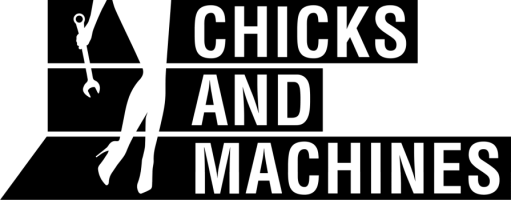




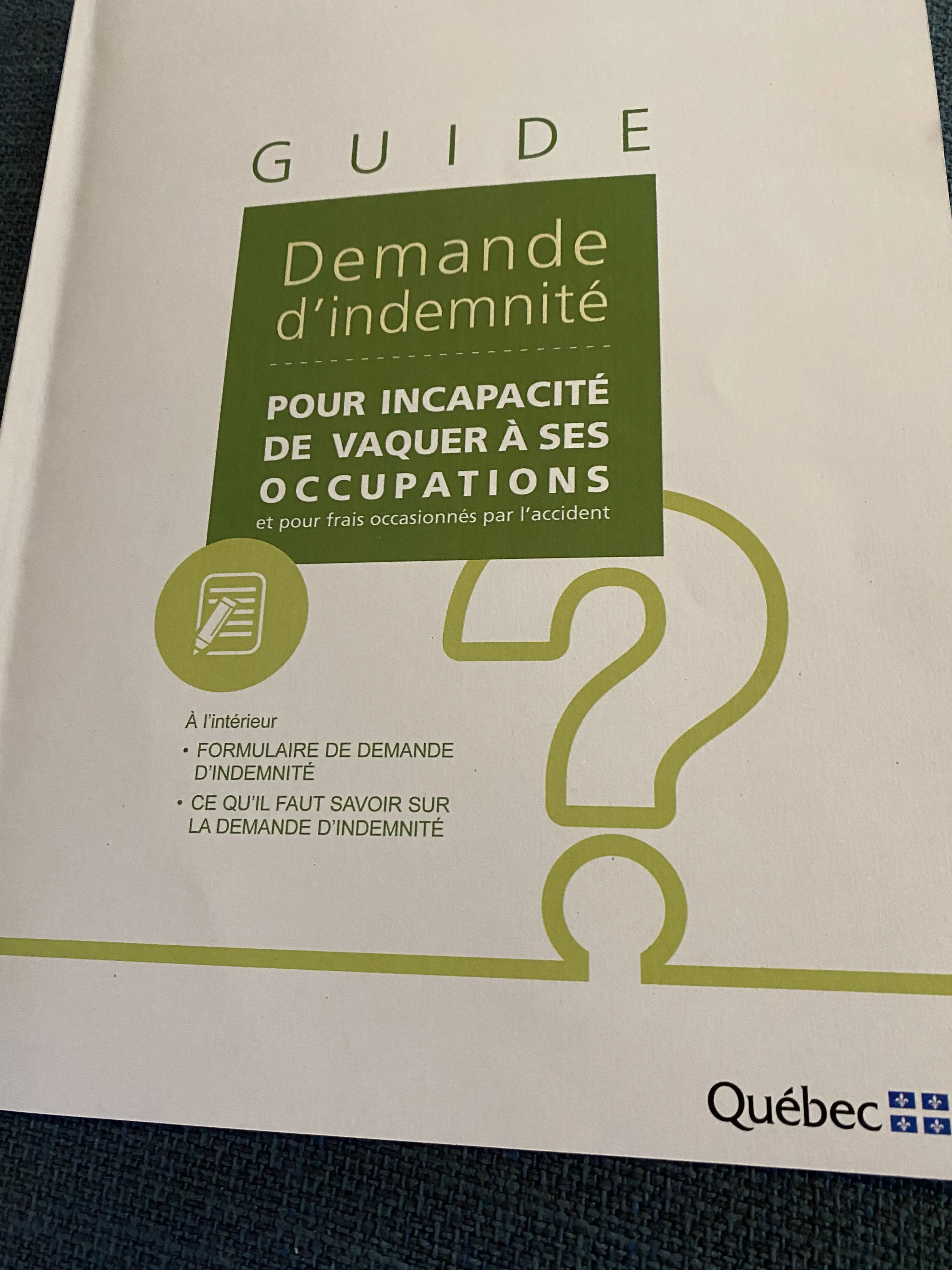

1 Commentez
Très utile
Je ne savais pas pour la fédération
Je suis moi meme une accidentée de la route depuis peu
Merci